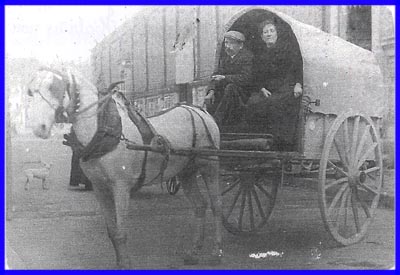|
PATRIMOINE ETHNOGRAPHIQUE
|
|
Savoir faire traditionnels
|
|
Marchands de poissons
|
|
Le "franc-salé"
|
 En décembre
1895, les sieurs Laurent Sert, Victor Mazo, Bénoni Carbonel, Astolphe
Azibert, Bénas Bérenger, poissonniers expéditeurs à
Gruissan, demandent le privilège du "franc-salés". En décembre
1895, les sieurs Laurent Sert, Victor Mazo, Bénoni Carbonel, Astolphe
Azibert, Bénas Bérenger, poissonniers expéditeurs à
Gruissan, demandent le privilège du "franc-salés". |
 Le franc-salé
était le droit qu'avaient quelques officiers ou communautés
de prendre du sel aux greniers des villes, franc d'impôt, ne payant
que le droit de marchand. Le franc-salé
était le droit qu'avaient quelques officiers ou communautés
de prendre du sel aux greniers des villes, franc d'impôt, ne payant
que le droit de marchand. |
 Ces requérants
ont essuyé plusieurs refus car pour le Directeur de l'Administration
des Douanes à Perpignan, cette demande ne présente pas le
caractère d'intérêt général nécessaire.
A l'appui de ce rejet ce directeur affirme qu'à cette époque
il n'y a à Gruissan que cinq bateaux se livrant à la pêche
de la sardine, montés seulement par cinquante hommes. Ces requérants
ont essuyé plusieurs refus car pour le Directeur de l'Administration
des Douanes à Perpignan, cette demande ne présente pas le
caractère d'intérêt général nécessaire.
A l'appui de ce rejet ce directeur affirme qu'à cette époque
il n'y a à Gruissan que cinq bateaux se livrant à la pêche
de la sardine, montés seulement par cinquante hommes. |
 Les Gruissanais
contestent ces chiffres car, "d'après les statistiques de
la pêche en 1894 le village compte 720 inscrits marins, 161 bateaux
et 238 marins employés ; la quantité de poissons pêchée
189 530 kg pour une valeur de 129 476 francs, 220 hl de coquillages pour
une valeur de 5 910 francs". Les Gruissanais
contestent ces chiffres car, "d'après les statistiques de
la pêche en 1894 le village compte 720 inscrits marins, 161 bateaux
et 238 marins employés ; la quantité de poissons pêchée
189 530 kg pour une valeur de 129 476 francs, 220 hl de coquillages pour
une valeur de 5 910 francs". |
 "Si nous
relevons de ces chiffres les quantités propres à la salaison
et qui en grande partie ont été vendues aux saleurs de l'Hérault
et des Pyrénées-Orientales, on trouve la perte suivante soufferte
par les poissonniers de Gruissan, sur le bénéfice de la vente,
à savoir : 10 150 kg de sardines, 9 550 kg de maquereaux, 22 250
kg d'anguille. "Si nous
relevons de ces chiffres les quantités propres à la salaison
et qui en grande partie ont été vendues aux saleurs de l'Hérault
et des Pyrénées-Orientales, on trouve la perte suivante soufferte
par les poissonniers de Gruissan, sur le bénéfice de la vente,
à savoir : 10 150 kg de sardines, 9 550 kg de maquereaux, 22 250
kg d'anguille. |
 C'est un total
de 41 950 kg de poissons vendus à bas prix pour la salaison". C'est un total
de 41 950 kg de poissons vendus à bas prix pour la salaison". |
 En 1895, 112 850
kg de sardines et maquereaux ont été pêchés. En 1895, 112 850
kg de sardines et maquereaux ont été pêchés. |
 Lorsque la pêche
est fructueuse ce qui d'ailleurs arrive plusieurs fois tous les ans, les
poissonniers sont obligés d'aller à Sète, Agde ou Coullioure
"en vendre une grande partie à ceux-là mêmes
qui jouissent du privilège du "franc-salés" et qui
achètent le poisson à un prix dérisoire attendu que
lorsqu'ils arrivent à destination la marchandise est en mauvais état
et ne pourrait supporter un autre voyage. L'intérêt de la commune
est donc en jeu, en souffrance même et se trouve sacrifié aux
intérêts de certaines localités qui ont ce privilège
et qui n'ont pas à coup sûr la quantité de poissons
dont nous pouvons disposer". Lorsque la pêche
est fructueuse ce qui d'ailleurs arrive plusieurs fois tous les ans, les
poissonniers sont obligés d'aller à Sète, Agde ou Coullioure
"en vendre une grande partie à ceux-là mêmes
qui jouissent du privilège du "franc-salés" et qui
achètent le poisson à un prix dérisoire attendu que
lorsqu'ils arrivent à destination la marchandise est en mauvais état
et ne pourrait supporter un autre voyage. L'intérêt de la commune
est donc en jeu, en souffrance même et se trouve sacrifié aux
intérêts de certaines localités qui ont ce privilège
et qui n'ont pas à coup sûr la quantité de poissons
dont nous pouvons disposer". |
 Dans sa délibération,
le Conseil Municipal, "considérant que la réouverture
par un canal du Grau du Grazel donnera accès aux bateaux de pêche
et qu'il est de toute équité que les poissonniers de Gruissan
puissent litter à armes égales avec les saleurs de l'Hérault
et des Pyrénées-Orientales, demande à l'administration
Supérieure compétente de faire une nouvelle enquête
et d'accorder le privilège du franc-salés à tous les
poissonniers expéditeurs qui pourront justifier l'emploi du sel soit
en fondant des ateliers de salaison de sardines qui se renferment dans des
barils, soit en salant d'autres poissons". Dans sa délibération,
le Conseil Municipal, "considérant que la réouverture
par un canal du Grau du Grazel donnera accès aux bateaux de pêche
et qu'il est de toute équité que les poissonniers de Gruissan
puissent litter à armes égales avec les saleurs de l'Hérault
et des Pyrénées-Orientales, demande à l'administration
Supérieure compétente de faire une nouvelle enquête
et d'accorder le privilège du franc-salés à tous les
poissonniers expéditeurs qui pourront justifier l'emploi du sel soit
en fondant des ateliers de salaison de sardines qui se renferment dans des
barils, soit en salant d'autres poissons". |
 Rappelons que
Gruissan ne possède pas encore de salins. Rappelons que
Gruissan ne possède pas encore de salins. |
 Aucune réponse
favorable n'étant parvenue, les sardines de Gruissan ont peut-être
manqué là, l'occasion de devenir aussi célèbres
que les anchois de Coullioure. Aucune réponse
favorable n'étant parvenue, les sardines de Gruissan ont peut-être
manqué là, l'occasion de devenir aussi célèbres
que les anchois de Coullioure. |
|
Au Halles de Narbonne
|
 Durant une longue
période les marchands de marée, ont dressé leurs étals,
à Narbonne, Passage de l'Ancien Courrier (de l'Ancre aujourd'hui),
et plus tard au Cagnard de Bourg. Durant une longue
période les marchands de marée, ont dressé leurs étals,
à Narbonne, Passage de l'Ancien Courrier (de l'Ancre aujourd'hui),
et plus tard au Cagnard de Bourg. |
 Vers 1875, la Mairie
de la ville décide de trouver un lieu pour regrouper tous les commerces
de bouche. Vers 1875, la Mairie
de la ville décide de trouver un lieu pour regrouper tous les commerces
de bouche. |
 Le 15 février
1899 les travaux commecent. Le 15 février
1899 les travaux commecent. |
 Les étals
sont mis aux enchères du 15 au 23 décembre 1900. Les étals
sont mis aux enchères du 15 au 23 décembre 1900. |
 Quelques mareyeurs
gruissanais firent alors l'achat de "places" : Carbonel,
Berthomieu pour ne citer qu'eux. Quelques mareyeurs
gruissanais firent alors l'achat de "places" : Carbonel,
Berthomieu pour ne citer qu'eux. |
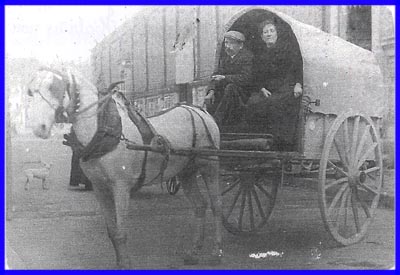 Louise et François Berthomieu arrivant
Louise et François Berthomieu arrivant
aux Halles de Narbonne vers les années 1910
|
 Seul aujourd'hui,
l'étal du second appartient encore à la famille et depuis
quatre générations. Seul aujourd'hui,
l'étal du second appartient encore à la famille et depuis
quatre générations. |
 Louise Berthomieu
"a tenu le banc" avec Baptistine Dimon, sa soeur. Louise Berthomieu
"a tenu le banc" avec Baptistine Dimon, sa soeur. |
 Dans les années
1938, Louis et Gaby Dimon leur int succédé, leur fille colette
Fontès a pris la relève et aujourd'hui c'est l'arrière
petit-fils Bernard Fontès qui est à la tête de l'entreprise. Dans les années
1938, Louis et Gaby Dimon leur int succédé, leur fille colette
Fontès a pris la relève et aujourd'hui c'est l'arrière
petit-fils Bernard Fontès qui est à la tête de l'entreprise. |
 Le 1er janvier
1901 les commerçants prennent possossion de leurs étals. Le 1er janvier
1901 les commerçants prennent possossion de leurs étals. |
 Par suite d'un
litige avec le constructeur, l'inauguration officielle n'eut lieu qu'au
mois d'avril 1901. Par suite d'un
litige avec le constructeur, l'inauguration officielle n'eut lieu qu'au
mois d'avril 1901. |

aux Halles de Narbonne dans les années 1950 |
1 - Marie-Louise Carbonel
2 - André Carbonel
3 - Gaby Dimon
4 - Louis Dimon
|
Cf : Gruissan d'Autrefois n° 201 - Source : Archive Municipales de Gruissan.
Photographies communiquées par Guy Carbonnel et Colette Fontès.
F. G. |