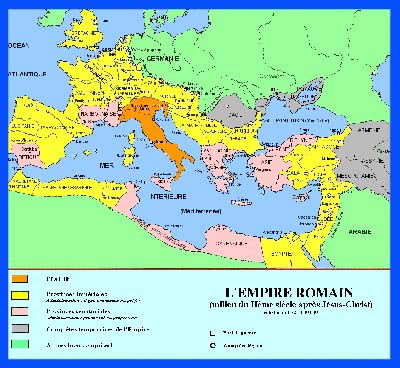PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
ANTIQUITÉ
Le Site de Saint - Martin

Signalétique
pour accéder au site archéologique
Photo F. Graulle - GRASG

Photo J. Graulle - GRASG
![]() Le site archéologique
de Saint-Martin se situe au Sud de l'Ile, vers l'embouchure du ruisseau
de Saint-Martin.
Le site archéologique
de Saint-Martin se situe au Sud de l'Ile, vers l'embouchure du ruisseau
de Saint-Martin.
A proximité, dès 1908, sur la proprièté de
"l'Evêque", sont trouvés : un pied de vase gallo-romain
en bronze, des poteries gallo-romaine, des monnaies et divers objets antiques.

Photo C. Graulle - GRASG
![]() Deux campagnes
de sondages en 1988 et 1990 à la demande du Groupe de Recherches
Archéologiques Subaquatiques Gruissanais (G.R.A.S.G.) ont permis
une première approche de la chronologie du site, entre le 1er siècle
avant notre ère et le 5ème siècle de notre ère.
Deux campagnes
de sondages en 1988 et 1990 à la demande du Groupe de Recherches
Archéologiques Subaquatiques Gruissanais (G.R.A.S.G.) ont permis
une première approche de la chronologie du site, entre le 1er siècle
avant notre ère et le 5ème siècle de notre ère.
![]() La campagne
de fouilles, réalisée en 1999, a mis en évidence
un ensemble de structures
bâties don,t notament, une construction
en grand appareil datée du 1er siècle avant notre ère,
d'un hypocauste et de nombreux autres éléments. Une réoccupation
médiévale est attestée par la découverte de
silos. De nombreux remaniements du site témoignent d'une utilisation
jusqu'à l'antiquité tardive.
La campagne
de fouilles, réalisée en 1999, a mis en évidence
un ensemble de structures
bâties don,t notament, une construction
en grand appareil datée du 1er siècle avant notre ère,
d'un hypocauste et de nombreux autres éléments. Une réoccupation
médiévale est attestée par la découverte de
silos. De nombreux remaniements du site témoignent d'une utilisation
jusqu'à l'antiquité tardive.

Photo J. Graulle - GRASG
![]() Seule une reprise
extensive des fouilles permettra de définir le rôle et l'importance
de cet ensemble. Dans l'attente d'une équipe compétente,
ce site est actuellement fermé.
Seule une reprise
extensive des fouilles permettra de définir le rôle et l'importance
de cet ensemble. Dans l'attente d'une équipe compétente,
ce site est actuellement fermé.

Tuile de toiture (Tegulae)
Photo F. Graulle - GRASG

Meule à grain
Photo F. Graulle - GRASG


Four à pain
Photo F. Graulle - GRASG

Toiture romaine
Photo F. Graulle - GRASG

Canalisation en tuile demi vouté
Photo F. Graulle - GRASG

Canalisation en tuile fermée
Photo F. Graulle - GRASG

Partie parties supérieure et inférieure d'une colonne
Photo F. Graulle - GRASG
![]() Ici, on aperçoit
lors des fouilles de 2013, deux des quatres amphores qui
ont été mis à jour, celle de gauche à moitié
cassé et celle de droite presque entière (manque que le
col et les anses)
Ici, on aperçoit
lors des fouilles de 2013, deux des quatres amphores qui
ont été mis à jour, celle de gauche à moitié
cassé et celle de droite presque entière (manque que le
col et les anses)

Photo F. Graulle - GRASG

Photo F. Graulle - GRASG
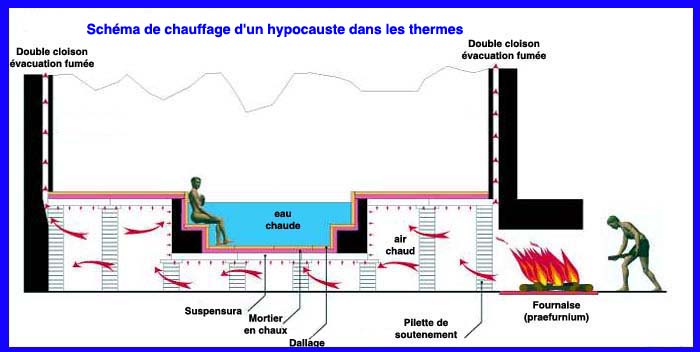

(photo 1)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 2)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 3)
"Vieux-la-Romaine"

(photo 4)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 5)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 6)
Photo F. Graulle - GRASG
![]() Nous arrivons
sur un sol en "opus spicatum" en épi de
blé ou "opus psicatum" en arète
de poisson, (photo 7), qui servait ici de dallage d'une citerne
alimentant en eau douce les thermes ci-dessus.La présence d'un
puits voisin laisse penser que ce dernier alimentait la citerne
Nous arrivons
sur un sol en "opus spicatum" en épi de
blé ou "opus psicatum" en arète
de poisson, (photo 7), qui servait ici de dallage d'une citerne
alimentant en eau douce les thermes ci-dessus.La présence d'un
puits voisin laisse penser que ce dernier alimentait la citerne
Le dalage de cette dernière était posé sur un sol constitué d'une chape à base de chaux, de brique pilée et de cailloux (photo 8).

(photo 7)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 7a)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 8)
Photo F. Graulle - GRASG

mur romain
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 9)
Photo F. Graulle - GRASG
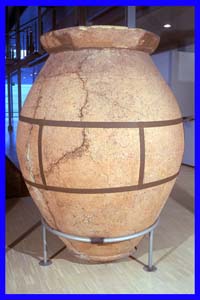
Dolium entier
(Musée Gallo-romain de Saint-Romain)

(photo 10)
Photo S.Sanz - CNRS

(photo 11)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 12)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 13)
Photo F. Graulle - GRASG
Un second hypocauste, de dimensions moindres à celui précédemment cité, apparaît au sud du site (photo14) Les archéologues avancent l'hypothèse d'un ouvrage à usage privé (destiné au responsable du site?) et non d'un bâtiment public.
Une canalisation, fort bien conservée,(photo 15) réalisée tardivement au dessus d'ouvrages plus anciens, aurait été destinée à ll'évacuation des eaux de pluie de la cour intrieure.

(photo14)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo14)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo15)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 17)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 18)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo19)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 20)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 21)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 22)
Photo F. Graulle - GRASG

(photo 23)
Photo F. Graulle - GRASG

Photo F. Graulle - GRASG
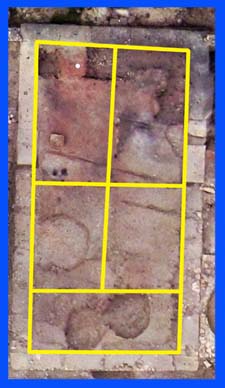
(photo 24)
Photo S.Sanz - CNRS

(photo 25)
Dessin et DAO Cl.Leger - CNRS

Photo F. Graulle - GRASG


(photo 26)
Dessin et DAO Cl.Leger - CNRS
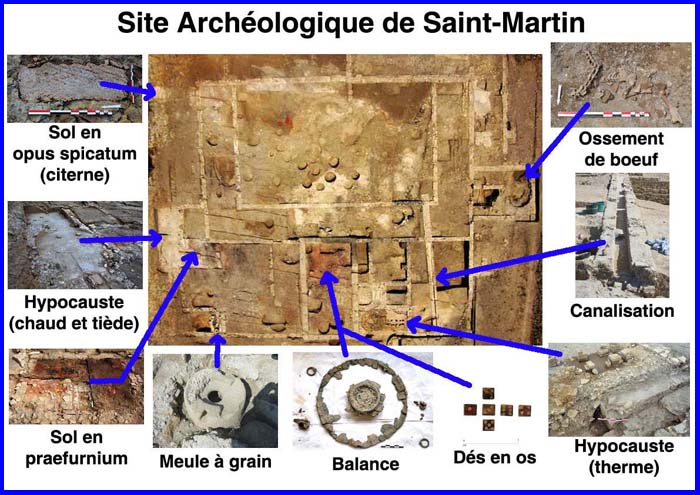
Photo aérienne S.Sanz - CNRS / Dessin et DAO Cl.Leger - CNRS - Montage F. Graulle

Vue aérienne 1999
Photo J. Graulle - GRASG

Vue aérienne 2012
Photo S.Sanz - CNRS

Vue aérienne 2013
Photo S.Sanz - CNRS

Superficie approximatif du site portuaire
Photo J. Graulle - GRASG
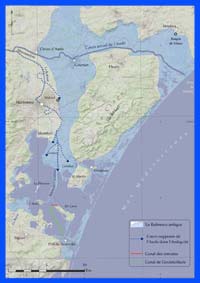
Le fleuve l'Aude à l'époque romaine

Configuration de la côte méditerranéenne
de l'époque romaine et maintenant
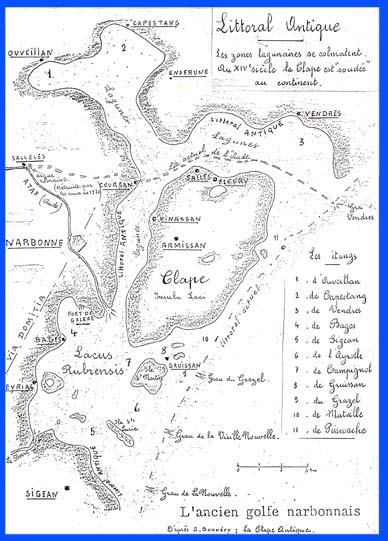
Référence bibliographique
* H. ROUZAUD - 1908 - p LVI.4
* GUY - 1955 - article sur les ports de Narbonne.
* D. PAYA - 1988 - Sondage.
* C. GRAULLE - 1990 - Sondage.
* C. SANCHEZ- 1999 - Fouilles programmée de l'Ile Saint-Martin.
* J. B LEBRET - 2011 - Etude approfondit de l'Ile Saint-Martin.
* S. MAUNE et G. DUPPERON - 2011 à 2013 et G. DUPPERON - 2013 à
2016 - Fouilles programmée de l'Ile Saint-Martin.
 |

|
|
 |
 |
 |
|
Ville de Gruissan
|
G.R.A.S.G.
|
Ministère de la Culture
|
C.N.R.S.
|
la Région Languedoc-Roussillon
|
l'Université Montpellier 3
|
Cf : G.R.A.S.G.
J. M, A. C, J. G et F. G